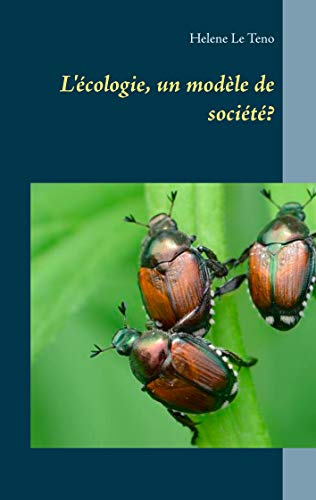Hélène Le Teno
Hélène Le Teno
On a aujourd’hui l’impression d’une certaine incompréhension entre une partie des consommateurs et du monde agricole. Comment en est-on arrivé là ?
Le monde agricole est aujourd’hui sous forte tension pour plusieurs raisons. La première est le facteur humain : la pyramide des âges des agriculteurs en France rend le renouvellement des générations et la transmission des exploitations particulièrement délicate. Cela se traduit par un ensemble de conséquences, notamment : perte de transmission de savoir-faire, interrogations sur le modèle d’avenir et l’agrandissement des exploitations. Le deuxième élément à souligner est que l’agriculture française, dans sa majorité, s’est développée ces cinquante dernières années sur un système que l’on pourrait qualifier de « techno-centré » se matérialisant par le développement du machinisme, le recours à la chimie et à la génétique. Cela a permis de considérablement diminuer la pénibilité du travail en agriculture et d’améliorer la quantité et la qualité des aliments. Mais cela a également eu comme conséquences un verrouillage du système socio-technique de production. Sur le plan social, le jeu d’acteurs et d’organisation en place favorise la reproduction des mêmes pratiques et freine l’innovation. Sur le plan technique, le système actuel est très intense en technologies et encore peu centré sur l’acquisition de nouveaux savoirs basés sur l’agroécologie et le vivant. Ensuite, il y a bien évidemment une crise écologique se traduisant par un bouleversement profond des écosystèmes, illustré entre autres par le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Enfin, il ne faut pas oublier l’évolution de la société vers sa métropolisation : l’essentiel de la population vit désormais dans des zones urbaines et connaît peu la nature, le vivant et l’agriculture, tout en ayant de nouvelles exigences environnementales fortes. Dans ce grand écart entre les urbains et les agriculteurs, on a l’impression d’une résurgence de conflits attisés par les médias. Ces attitudes ne permettent pas de trouver des voies de sortie vers le haut.
Justement, le débat médiatique n’est-il pas trop centré sur les agriculteurs, en oubliant qu’ils ne sont que les maillons d’une chaîne de responsabilité partagée ?
Dans le domaine agricole, il est nécessaire de bien comprendre que l’on est face à un jeu de poupées-gigognes à plusieurs niveaux. Au-delà de l’échelle de la ferme, il y a celle du territoire, puis celle plus globale de la France et du monde. Il faut s’intéresser au système agraire dans son ensemble – les coopératives, les fournisseurs d’intrants, les clients des agriculteurs, etc… – et non pas uniquement aux pratiques culturales, sur lesquelles les débats sont trop concentrés. Il faut penser l’agriculteur dans son environnement socio-économique : est-ce que par exemple son territoire est propice à l’évolution de ses pratiques ou au développement des circuits courts ? Est-ce que l’agriculteur est rémunéré pour la préservation des écosystèmes ? Raisonner à l’échelle globale des systèmes agraires oblige à défendre une vision partagée de la responsabilité des conséquences ou des manquements des activités agricoles. Or, dans les discours médiatiques, cette responsabilité n’est pas suffisamment partagée, ce qui a pour conséquence de focaliser les débats sur les affrontements stériles entre certains consommateurs et agriculteurs.
Si l’on veut réellement réussir une transition agricole et alimentaire compatible avec les limites écologiques, c’est localement qu’il faut agir.
Comment alors agir pour faire évoluer les pratiques agricoles de manière constructive, apaisée et efficace ?
Il faut d’abord poser plusieurs constats. Le premier est que le discours catastrophiste sur l’état de l’agriculture est totalement inefficace, bloque la créativité et le dialogique. D’un autre côté, le discours rationnel qui tend à prouver la nécessité et la viabilité de l’agroécologie a un impact très limité sur les changements de pratiques. Ces cinq dernières années, j’ai par exemple porté le plaidoyer de l’association Fermes d’Avenir dans la profession agricole, à l’Assemblée Nationale, dans les Ministères, et j’ai toujours constaté que les faits, les chiffres et les arguments ne provoquent pas de changements de comportement significatifs. Les spécialistes en psychologie et neurosciences l’expliquent très bien : on ne fait pas nécessairement de lien entre ce que l’on sait et ce que l’on fait. En réalité, les comportements et les choix sont conditionnés par l’habitude, l’éducation et les normes sociales. On en revient à des éléments de verrouillage du système socio-technique. On peut d’ailleurs raisonnablement supposer que la norme, la contrainte ou la fiscalité seront peu efficaces, ou trop lentement, pour faire évoluer un système verrouillé. Ceux-là même qui participent fortement à la mise en place des normes -les législateurs et les institutions- ne sont sans doute pas les plus à même de déverrouiller le système. Si l’on veut réellement réussir une transition agricole et alimentaire compatible avec les limites écologiques, c’est donc localement qu’il faut agir. L’un des principaux enjeux est donc de recréer du lien autour de projets concrets de transition agricole et alimentaire en allant bien au-delà de simples discussions. Chaque partie prenante doit être actrice du projet. Comme l’a parfaitement démontré Elinor Ostrom, économiste et Prix Nobel, la gestion de ce que l’on appelle les « biens communs », comme les forêts, la qualité de l’eau ou des terres agricoles, peut et doit se faire à l’échelle locale, avec les acteurs qui y vivent à proximité. Pour cela, il faut constituer des groupes de travail dont les membres prennent le temps de s’écouter, de partager les visions et les enjeux. Seulement dans un deuxième temps, les solutions et les moyens de les mettre en œuvre peuvent être développés.

Vous développez également la thèse selon laquelle les indicateurs économiques comptables que l’on utilise actuellement sont des composantes essentielles du verrouillage des changements de pratiques ?
Tout à fait. La comptabilité n’est pas qu’une histoire de chiffres, elle est aussi politique. Pour gérer son entreprise agricole dans la durée et la faire évoluer, il est central de disposer des bons indicateurs. Au sein de Fermes d’Avenir, nous avons travaillé sur la comptabilité en triple capital : comment à l’échelle d’une ferme, peut-on préserver à la fois le capital financier, naturel et humain ? Pour comprendre ce principe il faut distinguer les deux grands courants théoriques de la durabilité. Celui de la durabilité faible où l’on considère que les capitaux sont substituables entre eux. Dans cette logique, il est par exemple possible de compenser une terre agricole dégradée, le capital naturel, en investissant dans des engrais, un capital financier, pour continuer à produire. A l’inverse, dans un principe de durabilité forte, il est indispensable de maintenir séparément des niveaux satisfaisants des trois capitaux qui ne sont pas substituables entre eux, sous peine de créer une impossibilité de produire. Par exemple, on a beau avoir investi dans le plus beau des tracteurs, si le carburant qui le fait avancer devient une ressource limitante ou onéreuse, on aura du mal à produire. Une comptabilité en triple capital permet donc d’intégrer la nécessaire préservation de la ressource pour évaluer la pérennité des activités de production. Cela permettrait, par exemple, d’afficher dans le bilan comptable d’une ferme l’état des sols ou de la biodiversité qui sont autant de ressources garantissant la capacité de la ferme à produire sur le long terme et donc à rémunérer ceux qui cultivent.
Au final, prendre en compte le capital naturel dans la mesure de la durabilité des fermes ne va-t-il pas encourager une agriculture « low-tech » économe en énergie ?
Il serait tout à fait raisonnable au vu de l’état des ressources mondiales et des tensions qu’il peut y avoir sur les quantités disponibles ou sur les prix de concevoir des schémas d’agriculture plus sobres en technologies et en énergies, ce qui est le contraire des grandes tendances actuellement en Europe. Mais attention, cela impliquerait de se heurter à une double pénurie. Une pénurie de savoir-faire : comment conduit-on une agriculture faible en technologie ? Et une pénurie de main d’œuvre, puisque moins de technologies dans les champs nécessite généralement plus de bras. Cela ouvre une question à mon sens centrale et inévitable à se poser : quelle sera demain l’attractivité du métier d’agriculteur et donc sa reconnaissance dans la société ? Le métier d’agriculteur a toujours été difficile, et soumis à beaucoup d’aléas. Du fait de son haut niveau de risques, et des enjeux de demain, sa reconnaissance dans la société devrait être bien plus importante.