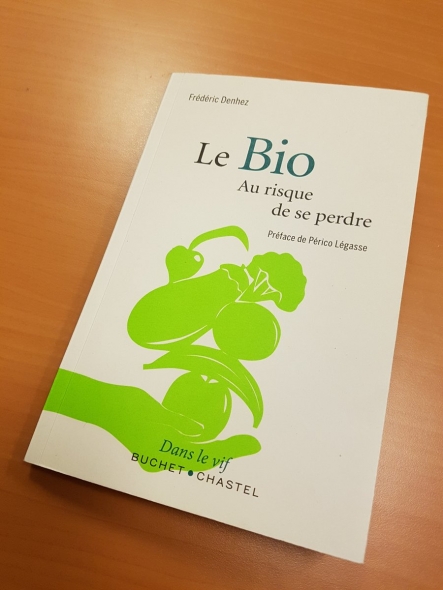Frédéric Denhez, auteur et journaliste à France Inter (« C02 Mon amour »)
Frédéric Denhez, auteur et journaliste à France Inter (« C02 Mon amour »)
Pourquoi d’après-vous, comme l’indique le titre de votre livre, « le bio risque-t-il de se perdre » ?
Le bio risque de se perdre dans son succès. L’extraordinaire croissance du marché bio pourrait en atténuer la philosophie. Ce succès est le signe, pour les défenseurs de cette agriculture, d’une victoire qui pourrait bien être demain à la Pyrrhus, voire même synonyme d’une édulcoration du contenu de son cahier des charges. Le risque est que le bio ne soit demain plus aux mains de ceux qui le font, mais de ceux qui le distribuent. Enfin le bio risque de se perdre également dans des postures manichéennes, car il est censé représenter le camp du bien et le conventionnel, le camp du mal. Ces postures font peur à la fois aux agriculteurs et aux consommateurs qui ont envie de changer leurs pratiques.
Les grandes surfaces sont-elles une menace pour le développement du bio ?
Pour le moment, la grande distribution n’est pas une menace, car elle distribue en France à peu près la moitié des produits bio consommés. Mais cela pourrait le devenir dès lors que l’essentiel de la production serait vendu via la grande distribution. Lorsqu’elle s’intéresse à un marché, la grande distribution contribue certes à le lancer, mais elle a ensuite tout intérêt à le contrôler. Et ce contrôle s’opère bien souvent avec les méthodes qui sont les siennes, celles-là même qui ont fait que le monde paysan s’est retrouvé entre ses mains. Des mécanismes d’achat de volumes importants sous le prix de revient des productions et des négociations tarifaires très déséquilibrées au désavantage des producteurs en sont les exemples les plus criants. En ce qui concerne le bio, jusqu’à présent, l’offre créé le prix. Mais, le risque est que, du fait de l’augmentation de la demande, les grandes surfaces augmentent leurs importations, obligeant ainsi les producteurs français à baisser leurs prix ou à vendre via les centrales d’achats des supermarchés. Enfin, je pense profondément que, dans sa philosophie, la bio est antinomique avec la grande distribution, de par le seul fait qu’elle trouve toute sa pertinence dans la notion de local.

Est-ce à dire que la production biologique, si elle ne veut pas se perde, est inconciliable avec le fait de nourrir d’énormes agglomérations de plusieurs dizaines de milliers d’habitants ?
C’est la bonne question, et la seule à se poser. Dans un pays manichéen comme la France, le bio pourrait être condamné à un marché de niche à haute valeur ajoutée ou, à l’opposé, à un marché très grand public tenu par la grande distribution. Or, il y a évidemment de la place pour les deux, si tenté est que les rapports de force soient équilibrés, ce qui n’est pas le cas du tout actuellement, puisque la grande distribution fait la pluie et le beau temps. Je reste convaincu que la bio peut, en France, nourrir une bonne partie de la population, car ce pays est béni des dieux du point de vue de sa diversité de sols et de climats : on peut réussir à faire à peu près tout pousser sans recourir massivement aux intrants. La bio peut donc nourrir la France si la valeur ajoutée est avant tout aux mains d’abord des paysans, ensuite des transformateurs et enfin des distributeurs. Mais cette vision n’est réaliste que si le contribuable accepte de mettre la main à la poche pour soutenir ce mode de production. D’abord via les impôts qui vont permettre des aides agricoles pour accompagner les producteurs en transition vers le bio, période délicate techniquement et économiquement. Ensuite, par une hausse des prix des denrées alimentaires qui est inévitable : tant que l’alimentation sera un des budgets les moins importants d’un ménage, on aura du mal à faire évoluer les modèles agricoles.
D’un point de vue sémantique vous distinguez bien « le bio » de « la bio » ? Pourquoi cette distinction ?
Le bio c’est ce qu’il y a derrière la certification AB : c’est un cahier des charges qui n’est vraiment coercitif que sur le non-usage des intrants chimiques et des OGM pour l’alimentation du bétail. Pour le reste – les rotations, la diversité des cultures ou la fertilité des sols –, le cahier des charges énonce essentiellement des principes généraux, sans trop d’exigences précises. La bio c’est tout autre chose, c’est le principe général du bio auquel on ajoute le respect fondamental de toute la chaîne alimentaire : du paysan, du consommateur, des sols, du bétail, des variétés, de l’arbre dans le paysage… La bio, c’est produire en abîmant le moins possible le paysan, le consommateur et la nature. Cela passe évidemment par le non-usage des pesticides, mais d’abord et en premier lieu, par un moindre travail du sol et une vraie écologie agricole basée sur un travail permanent avec la nature et les arbres. Tout cela n’est pas dans le cahier des charges actuel du bio. En réalité la bio est un projet politique là où le bio est devenu un itinéraire de culture et de conduite d’élevage.
Concernant le respect du sol en particulier, vous expliquez que le bio a d’importantes marges de progrès et que des ponts avec d’autres formes d’agriculture, comme celle dite de conservation, sont à bâtir ?
Evidemment. Je pense qu’il faut décloisonner le bio d’autres modes d’agriculture vertueux. Je suis supporteur du bio en temps qu’objectif à atteindre, pas en tant que but en soi. Ce n’est pas parce qu’on se met au bio, qu’on fait forcément bien. Diverses agricultures se conforment ou vont à ce que j’appelle « la bio » par le non-labour, le semis direct, la couverture permanente des sols. Ces agriculteurs ne sont néanmoins pas nécessairement certifiés bio du fait des contraintes importantes qui y sont liées, sur la non-utilisation d’herbicide. Pour autant, même si ces agriculteurs font l’usage de produits phytosanitaires, leur système technique est plus qu’intéressant à mettre en avant, du fait notamment de ses effets très bénéfiques pour le maintien de la fertilité des sols, condition centrale pour la capacité de l’agriculture de nous nourrir à long terme. J’aimerai plus de ponts entre ces agricultures et le bio pour les faire progresser conjointement vers ce que j’appelle « la bio ».

Pour vous, les avantages nutritionnelles de la bio sont largement supérieurs à ceux du bio dans sa définition actuelle ?
L’aspect nutritionnel est un très bon exemple dans lequel on voit très clairement la différence entre le bio et la bio. Acheter une tomate bio qui répond au cahier des charges, c’est acheter la promesse d’un fruit produit sans pesticide, ce qui n’est déjà pas si mal, convenons-en. Une tomate qui correspond à la philosophie de la bio, c’est une tomate qui, certes a été produite sans pesticide, mais qui a été cueillie à maturité peu de temps avant sa vente car la bio a le principe du respect du produit. Cueillir un produit des semaines avant sa commercialisation, puis le conserver par réfrigération lui fait perdre l’essentiel de ces qualités nutritionnelles et gustatives. Un produit issu de la bio c’est donc la garantie qu’il a été cultivé sans pesticide, dans un sol riche et vivant et cueilli à maturité. Cela va même jusqu’au consommateur : les vertus sur la santé du bio disparaissent si l’hygiène de vie est discordante ou la cuisson des aliments non appropriée.
D’après-vous, il y aurait incompatibilité entre la bio et les régimes « sans », en particulier sans viande ?
C’est à mes yeux complètement incompatible. Les régimes « sans » en général, sont souvent un appel d’air pour l’industrie car il n’y a que cette dernière qui est capable de produire sans, pas la nature. Le véganisme est forcément incompatible avec le bio, et même avec l’agriculture en général d’un point de vue agronomique. L’agriculture n’est devenue mâture qu’au milieu du XVIIIème siècle grâce au développement de la polyculture-élevage. En introduisant le fumier dans l’assolement, l’association de la culture et de l’élevage a permis à l’Europe Occidentale d’en terminer avec les famines. Dans ses fondements agronomiques, le bio c’est cette agriculture-là, celle de la révolution agronomique en polyculture élevage, associée aux légumineuses et aux bocages. Cela est vraiment ancré dans la philosophie de la bio car un territoire n’est bio que s’il est autonome au niveau des intrants naturels et organiques. Se passer du fumier animal en utilisant du fumier végétal, reviendrait à un retour à l’agriculture d’avant le XVIIIème, c’est-à-dire une agriculture qui génère des famines. Les engrais purement végétaux ne sont jamais disponibles en quantité suffisante et épuisent rapidement les sols du fait de leur teneur insuffisante en matière organique. Et il ne faut pas oublier que le sol est une production animale en soit. Ceci étant dit, on peut tout à fait progresser sur les conditions d’élevage des animaux, cela doit même être au cœur de « la bio ».
Au final, comment faire évoluer le label du bio pour qu’il se rapproche au maximum de la bio ?
Tout d’abord, il faut rappeler que le principe de subsidiarité permet d’avoir une déclinaison de la certification bio européenne à l’échelle nationale. Il est donc possible de monter en exigence le cahier des charges au niveau français, en complément d’un cahier des charges européen, qui lui, resterait dans l’esprit de ce qui se fait aujourd’hui. Des producteurs pourraient alors juxtaposer les deux labels, en fonction de leurs pratiques. Pour l’écriture d’un nouveau cahier des charges, on pourrait imaginer revenir à la philosophie originelle de la bio, celle de Nature et Progrès ou du label biodynamique Demeter, sans ses considérations ésotériques. Il faudrait monter en exigence sur les pratiques de travail du sol afin de le diminuer, inciter à la réintroduction de l’arbre et des haies pour favoriser la biodiversité au sein des parcelles. En parallèle, une stratégie de mise en place d’une polyculture-élevage à l’échelle d’un bassin économique ou d’une vallée serait nécessaire à mettre sur pied. Enfin, il faudrait dans ce nouveau cahier des charges, absolument introduire des éléments sur la construction d’un prix juste pour les producteurs par filière, voire par filière territoriale pour s’adapter aux spécificités naturelles et climatiques d’une région.